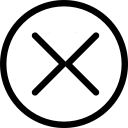previous article in this issue previous article in this issue | next article in this issue  |
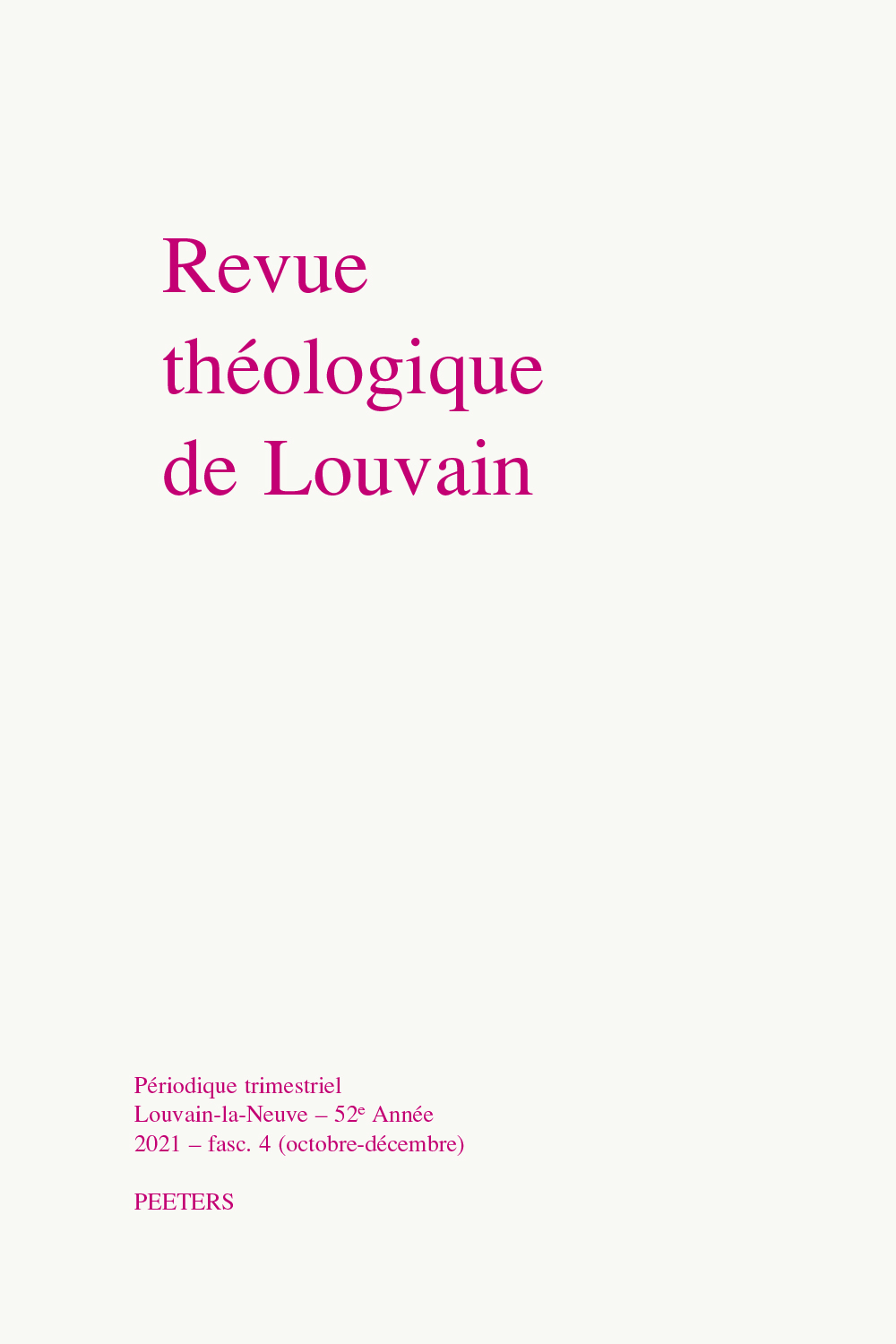
Preview first page |
Document Details : Title: Légitimité et dé-coïncidence Subtitle: Ce que la démocratie est en droit d'attendre de la théologie Author(s): BOURDIN, Bernard Journal: Revue Théologique de Louvain Volume: 55 Issue: 3 Date: 2024 Pages: 352-370 DOI: 10.2143/RTL.55.3.3293767 Abstract : Le concept de légitimité est moderne en ce sens que la pensée antique et médiévale l’ignorait. Il n’apparait véritablement qu’avec les discussions juridiques sur la légitimité des rois au cours des guerres civiles de religion. En France, il prend à nouveau de l’importance avec le légitimisme dynastique durant le XIXe siècle. Mais ces deux précédents historiques montrent aussi que ce concept appartient à un mode de pensée incompatible avec l’autonomie politique moderne. C’est pourquoi il est utilisé fréquemment sans rigueur intellectuelle pour contester la validité d’une élection ou d’un pouvoir. Pourtant, cet usage approximatif et potentiellement dangereux ne signifie-t-il pas que les régimes démocratiques ne peuvent se réduire à un ordre public légal? C’est par rapport à cette question que cet article tente d’apporter une autre approche du concept de légitimité. Plutôt que de le penser dans les termes d’une hétéronomie politico-religieuse, ne pourrait-il pas être pensé comme ce qui dé-coïncide à l’intérieur de tout ordre légal et toute norme sociale? Dans cette perspective, n’est-ce pas redonner une nouvelle crédibilité au discours théologique dans la sphère publique? The concept of legitimacy is modern in the sense that ancient and medieval thought ignored it. It only really appears with legal discussions on the legitimacy of kings during religious civil wars. In France, it gained importance again with dynastic legitimism during the 19th century. But these two historical precedents also show that this concept belongs to a way of thinking incompatible with modern political autonomy. This is why it is frequently used without intellectual rigor to contest the validity of an election or a power. However, does this approximate and potentially dangerous usage not mean that democratic regimes cannot be reduced to legal public order? It is in relation to this question that this article attempts to provide another approach to the concept of legitimacy. Rather than thinking of it in terms of a political-religious heteronomy, could it not be thought of as that which de-coincides within any legal order and any social norm? From this perspective, does this not restore new credibility to theological discourse in the public sphere? |
|